Les personnes handicapées font face à des dépenses de 10 à 40 % plus élevées : les transferts monétaires prennent-ils cela en compte ?
Les recherches révèlent que les personnes handicapées font face à des coûts en moyenne plus élevés pour atteindre la même qualité de vie que les personnes non handicapées. Dans ce blog, le Dr Manuel Rothe s’interroge sur la prise en compte de ces coûts supplémentaires dans les interventions humanitaires et sur leurs effets sur la capacité des personnes en situation de handicap à couvrir leurs besoins essentiels. Il réfléchit à ce que nous pouvons faire pour nous assurer que les transferts monétaires fournissent un soutien équivalent à toutes les personnes pendant une crise, qu’elles soient handicapées ou non.

L’objectif des transferts monétaires en situation de crise humanitaire est d’aider les populations affectées à répondre à leurs besoins dignement. Le montant des transferts monétaires est généralement basé sur un panier de dépenses minimum qui définit ce dont les personnes et les ménages ont besoin pour répondre à leurs besoins essentiels et leurs dépenses, calculées en fonction du marché local.
Les transferts monétaires humanitaires prennent-ils en compte ces 10 à 40 % de dépenses supplémentaires ?
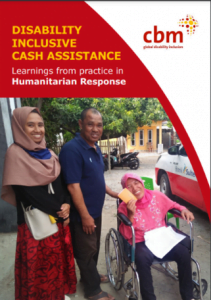
Les données probantes tirées d’une analyse des programmes de transferts monétaires à usages multiples gérés par CBM Global dans divers contextes humanitaires montrent que les personnes en situation de handicap ont des besoins spécifiques, qui vont au-delà des éléments d’un panier de dépenses minimum typique. On peut notamment citer des moyens de transport accessibles, certains besoins alimentaires et articles d’hygiène, des couvertures supplémentaires et des vêtements adaptés, des médicaments et des traitements spécifiques, ou le remplacement/la réparation de dispositifs d’assistance. Si les transferts monétaires humanitaires ne suffisent pas à répondre de manière adéquate à ces besoins, les personnes handicapées ne peuvent pas participer équitablement et profiter de cette aide.
Ces conclusions vont dans le sens de recherches réalisées sur le coût de la vie pour les personnes handicapées, hors contextes humanitaires. En 2017, une méta-analyse de 20 articles de journaux réalisée par des pair·es sur le thème des coûts associés au handicap a montré que les personnes handicapées devaient s’acquitter de dépenses supplémentaires conséquentes pour atteindre la même qualité de vie que les personnes non handicapées. L’estimation des coûts supplémentaires allait de 10 % à 40 % et on remarquait des points communs entre les analyses : les coûts variaient en fonction du degré de handicap et de la composition des ménages. Les coûts les plus élevés concernaient les personnes ayant un handicap grave et les personnes handicapées vivant seules ou dans des ménages de petite taille.
La manière dont sont calculés les montants des transferts monétaires pour les personnes handicapées doit changer.

Pour les acteurs humanitaires, la conclusion est claire : pour que les personnes handicapées puissent couvrir leurs besoins essentiels de manière équitable, le calcul du panier de dépenses minimum, les évaluations des besoins multisectorielles et les montants des transferts monétaires doivent tenir compte des coûts supplémentaires auxquels elles font face. Comment y parvenir ? D’abord, au moyen de données de qualité.
L’analyse du panier de dépenses minimum doit être basée sur des données inclusives, ventilées en fonction du handicap. La collecte et l’analyse des données doivent être basées sur l’auto-identification, à l’aide d’outils testés dans des contextes humanitaires, comme les questionnaires du Groupe de Washington. La participation des personnes handicapées et de groupes les représentant est indispensable. L’analyse doit refléter leurs perceptions et leurs inquiétudes, mais aussi utiliser et reconnaître leur expertise afin d’identifier leurs besoins et les barrières qu’elles rencontrent.
Ensuite, les acteurs humanitaires doivent évaluer les besoins et exigences spécifiques des personnes handicapées. Certains besoins s’inscriront en dehors de la portée des transferts monétaires à usages multiples et relèveront d’une assistance ciblée supplémentaire, organisée en parallèle aux programmes de transferts monétaires. Ces besoins peuvent inclure la réparation ou le remplacement de dispositifs d’assistance ou la mise en place de moyens de transport accessibles jusqu’aux points de distribution et aux marchés. Il s’agit de conditions essentielles pour permettre aux personnes handicapées d’accéder aux programmes. Les acteurs humanitaires doivent également prévoir une programmation spécifique pour garantir la protection et la dignité des femmes et des filles handicapées et d’autres personnes proportionnellement plus à risque d’être laissées pour compte ou mises en danger.
L’aide humanitaire peut être équitable envers les personnes handicapées, mais seulement lorsque des mesures d’inclusion spécifiques sont en place. Les transferts monétaires et les coupons jouent un rôle important dans l’autonomisation des personnes handicapées en contexte de crise humanitaire. Il nous incombe de mettre en œuvre des outils et approches pensés pour des transferts monétaires inclusifs.
Participez à notre événement pour en savoir plus
Inscrivez-vous dès maintenant à notre événement en ligne Disability inclusion in humanitarian cash assistance, dans le cadre duquel nous explorerons plus avant les thématiques abordées dans ce blog. Cet événement est organisé par CBM Global, l’OIM et le CALP, et se déroulera de 13 h 00 à 14 h 30 UTC le 19 mai dans le cadre de la semaine des réseaux et partenariats humanitaires.
Vous pouvez également consulter la liste préparée par le CALP des événements sur les transferts monétaires à ne pas manquer lors de cette semaine.
Image principale : © Julie Smith / CBM Global
À propos de l’auteur :
Le Dr Manuel Rothe travaille pour des ONG internationales des secteurs humanitaire et du développement de différents pays depuis 2005. Il est actuellement responsable de programme humanitaire et point focal Transferts monétaires pour CBM Global.

À propos de CBM Global :
CBM Global travaille avec des personnes handicapées des régions les plus pauvres du monde pour transformer leur quotidien et créer des communautés inclusives où toute personne puisse jouir de ses droits humains et atteindre son plein potentiel. CBM Global et ses partenaires fournissent des transferts monétaires tenant compte du handicap depuis de nombreuses années dans des contextes de crise humanitaire.
À propos de l’OIM :
Fondée en 1951, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est l’organisation intergouvernementale cheffe de file dans le secteur des migrations. Elle est attachée au principe de migration humaine et ordonnée qui profite aux personnes migrantes et à la société dans son ensemble. L’OIM fait partie du système des Nations Unies, en tant qu’organisation associée. L’OIM soutient les personnes migrantes du monde entier, en mettant au point des interventions efficaces pour faire face aux dynamiques de migration changeantes. Elle est donc une source de conseils essentielle en termes de politiques et de pratiques migratoires. Elle travaille dans des situations d’urgence à accroître la résilience de toutes les personnes vivant l’expérience de la migration, en particulier celles qui sont vulnérables, et à renforcer les capacités de gestion de toutes les formes de mobilité (et de leurs impacts) au sein des gouvernements.